« Exposer des œuvres d’art au milieu d’une architecture qui hurle son existence jusqu’à la moindre poignée de porte n’est pas propice au recueillement nécessaire à la contemplation des œuvres » : l’architecte montpelliérain Yann Legouis juge sévèrement « cette protubérance du grand capital » à Arles, la petite Rome de Gaule, « maintenant une ville passablement défigurée« par un geste architectural de « boomer » (*).
Ce texte de Yann Legouis figure dans son Carnet critique, ici.
On garde cette impression étrange, en sortant de la fondation Luma d’Arles, d’avoir rendu visite à une tante esthéticienne à Lannemezan, qui aurait gagné une somme mirifique au loto. Et qui se serait fait arnaquer par un commercial schuco véreux, doublé d’un architecte gominé en décapotable, vêtu d’une chemise gardian dépoitraillé jusqu’au nombril.
À peine passées les portes automatiques -inévitablement en panne- du hall d’entrée, c’est d’abord un voyage extraordinaire qui est proposé : on passe de l’atmosphère si particulière qui baigne la ville sublime d’Arles pour être transporté sans ambages dans l’ambiance standardisée et feutrée d’un shopping mall du Wisconsin. Alors qu’on tend l’oreille, par réflexe, pour accueillir du Drake en sourdine, on cherche un peu désespérément des yeux la caisse -l’accueil- du lieu culturel. Et c’est la qu’on aperçoit, au fond, entre deux falaises en titane, vertigineuses de vacuité, un pauvre petit Chambord riquiqui, un escalier à double volée, qui sert de système de distribution à l’édifice.
Il a un cousin éloigné, la gloire de la famille, qui distribue subtilement les différents niveaux d’un château renaissance éponyme. Mais lui, semble coincée dans un angle, ou plutôt rejetée dans un repli de l’espace informe du musée. Parce qu’en plein cœur de la tour, trône en majesté le vrai clou du spectacle –ou du cercueil- : une double hélice de métal et de verre qui plonge sur 3 niveaux, un invraisemblable Toboggan Chambord. Une expérience architecturale tubulaire tout à fait inédite, ajoutant a la double postulation baudelairienne, le désir de monter et le plaisir de descendre, un troisième paramètre : l’envie de se barrer. Merci Gehry.

C’est loin d’être beau, et c’est aussi assez moche de prêt : il n’y a qu’à voir les cordons trop bombés des soudures des menuiseries, et les fenêtres de l’escalier qui tombe aléatoirement sur la volée, entrecoupée par les paliers, par les marches, par la main courante. Comme si l’autonomie du plan et de la façade, chacun dans son toboggan Chambord, était restée totale jusqu’à la réalisation. Une mauvaise surprise par étage. Tout brille, tout est mat, tout est texturé, tout est satiné, tout veut être brillant et réfléchissant à la fois : rien n’est domestiqué, ou ordonné. Un exemple éblouissant d’une architecture «des parties sans Tout», comme le décrirait certainement Karim Basbous dans son dernier opus indispensable Architecture et Dignité. Il y a à boire, et à manger aussi. Et Dieu sait combien le chameau est indigeste.
Un symbole d’inconvenance
Est-ce une salle vide ? Est-ce une œuvre d’art contemporain ? Difficile à dire. Ni tout à fait la white box de Meier au MACBA, ni tout à fait le musée paysage du Louisiana. Exposer des œuvres d’art au milieu d’une architecture qui hurle son existence et son autonomie jusqu’à la moindre poignée de porte n’est pas propice au recueillement nécessaire à la contemplation des œuvres. Ce qui est plus grave, c’est qu’on a du mal à imaginer un avenir clair pour cette série d’espaces informes empilés, trop petits, aux refends béton inamovibles, mal desservis, trop éclairés, et innettoyables. Quels usages pourraient succéder à sa fonction initiale ? Le vieux terme inusité de «convenance» souligne un des principes indispensables de l’architecture : la qualité de pouvoir se transformer sans cesse, pour se conserver, en fonction du programme qu’elle accueille. Ce bâtiment est donc un symbole d’inconvenance, inextricablement et éternellement lié a sa véritable fonction première : celui de faire exister une milliardaire suisse dans le sublime paysage arlésien, une sorte de cénotaphe par anticipation, figé dans une attitude mi-mollesque.

Et dans ce pays, ou pour changer les petits bois d’un soupirail de cave, il faut passer nécessairement sous les fourches caudines et sourcilleuses des architectes des bâtiments de France, la raison du plus riche aura eu raison de la raison d’État. Et cette tourlingue boudinée de titane ressemble bien plus au majeur tendu de l’architecte américain vers toutes les UDAP de France, qu’a une architecture muséale d’intérêt public. Il n’y a pas d’alternative au fuck the context, semble-nous résumer parfaitement cette architecture de boomer qui transpire les années 90.
Il faut boire le calice jusqu’à la lie, et se coltiner, dans la salle, tout droit en glissant au bout du toboggan, l’interview en écran géant 4k dolby surround de l’architecte Frank Gehry, qui vous explique sans rire que la lumière était là, que Bas Smet est gentil, quoiqu’un peu naze, et surtout que sa tour ressemble à la nuit étoilée de Van Gogh, morphing vidéo à l’appuis. Pauvre Vincent. Il vaut mieux se couper les deux oreilles qu’entendre des inanités pareilles.

Alors on est un peu triste, en regardant dans le rétroviseur, la belle ville d’Arles disparaître dans les brumes du Rhône. Comme un comédon longue durée sur le visage d’un ami cher, la dernière chose que l’on aperçoit avant de reprendre l’autoroute, c’est cette excroissance cyranesque, cette protubérance du grand capital. Arles, la petite Rome de Gaule, est maintenant une ville passablement défigurée par une milliardaire qui l’aimait trop, et par un architecte qui ne fait plus son travail, reprenant sans cesse ses tubes éculés sous les soleils basques, californiens ou saoudiens. Et c’est la faute à un État, normalement régulateur, qui est très fort avec les faibles, mais très faible avec les forts, incapable de dire non aux caprices des vieux.
Écouter l’entretien de Yann Legouis pour le podcast Genre urbain, ici.
(*) Ce bâtiment imaginé par Maja Hoffmann avec Frank Gehry -une tour de 15 000m², d’une hauteur de 56 m- abrite une salle d’exposition de 1000m², deux terrasses panoramiques aux 8ème et 9ème étages, un café-restaurant, un auditorium de 150 places, des ateliers d’artistes, une bibliothèque, des espaces d’archives, des espaces dédiés à l’événementiel, des salles de séminaire, des bureaux. En savoir +.


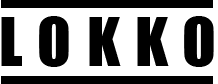

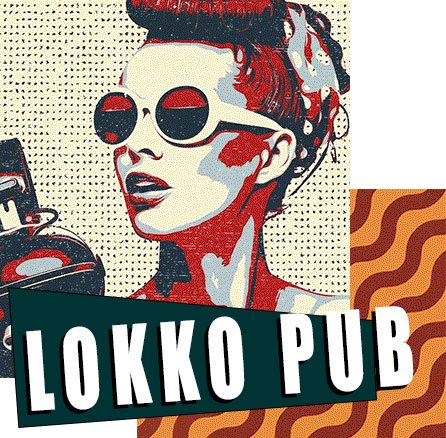

Une diatribe honteuse,
Pauvre L’égoïsme qui n’a rien compris
J’ai écrit « pauvre Le Gouis » et non égoïsme…